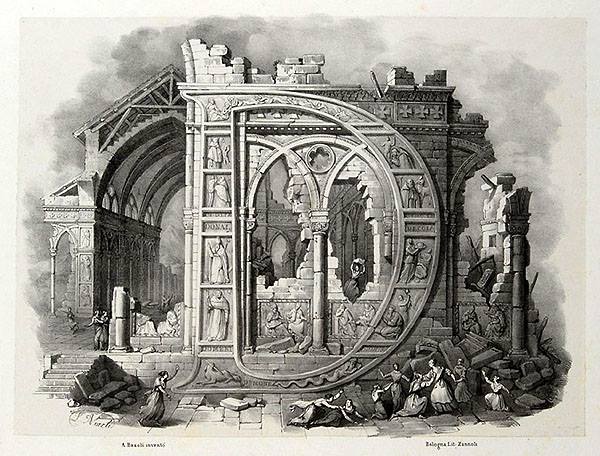Verità e buone maniere
from Alviro
C'è un'antica presunzione, diffusa tra coloro che si compiacciono di una certa rozzezza spirituale, secondo cui la verità sarebbe una sorta di clava, e che il suo valore sia direttamente proporzionale al dolore che essa infligge. Costoro scambiano la propria incapacità di dominare l'aggressività istintiva per una forma di coraggio intellettuale.
In realtà, la questione merita un esame più attento, libero da questa superstizione masochista. Se consideriamo la verità non come un'entità mistica, ma come una proposizione che corrisponde ai fatti, diventa subito evidente che la sua enunciazione è un atto sociale, e come tale soggetto a quelle leggi di cooperazione e cortesia che rendono possibile la convivenza civile. Dire la verità con garbo non significa edulcorarla o tradirla, ma semplicemente riconoscere che l'interlocutore è, al pari di noi, un fascio di nervi e suscettibilità, e che una comunicazione efficace richiede che il messaggio sia recapitato integro, e non distorto dalla violenza inutile del tono.
Si potrebbe obiettare che la brutalità sia, in certi casi, un dovere. Ma questa è una scusa pigra. La storia della conoscenza umana ci mostra che le verità più dirompenti – da Copernico a Darwin – sono state annunciate con la pacata fermezza di chi espone un teorema, non con lo strepito di chi demolisce un tempio. La violenza verbale è quasi sempre il rifugio di chi non ha argomenti, o di chi, pur avendoli, non si fida della loro forza intrinseca.
Vi è poi un punto ancora più profondo, che riguarda la natura stessa di chi parla. L'uomo che non sa controllare la propria lingua è, in un senso molto concreto, schiavo delle sue passioni. Non è lui a possedere la verità; è la sua ira, o il suo disprezzo, a possedere lui. In quelle condizioni, ciò che esce dalle sue labbra non è verità, ma un impasto indistinto di fatto e di sentimento personale, in cui il fatto viene inevitabilmente distorto per servire il sentimento.
Pertanto, lungi dall'essere un abbellimento superfluo, il garbo è la cartina di tornasole della veridicità di un'affermazione. Se non siete capaci di esprimere un pensiero se non insultando qualcuno, è probabile che quel pensiero non sia poi così solido. La cortesia, in questo senso, non è l'opposto della franchezza, ma la sua condizione necessaria: è l'igiene mentale che permette alla verità di essere ascoltata, e dunque di esistere come atto di comunicazione tra esseri razionali. Chi non sa controllare la lingua, in fondo, non cerca la verità, ma cerca una scarica adrenalinica. E di questo, almeno, dovrebbe avere l'onestà di ammetterlo.